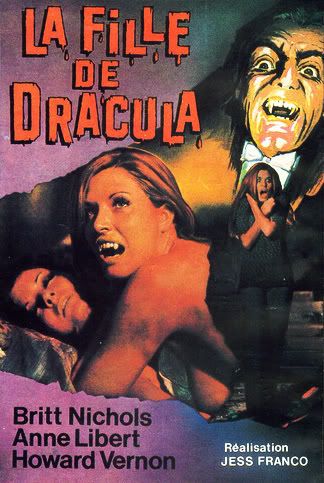Réalisé
par Jerry Spiegler, avec Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman…
Synopsis :
Alors que la planète Krypton est proche d’exploser, Jor-El et sa femme décident
d’envoyer leur fils, Kal-El, sur la planète Terre, dont les habitants sont bien
moins évolués que ceux de Krypton, pour le sauver d’une mort certaine. A son
arrivée sur Terre, il est recueilli par Martha et Jonathan Kent, qui le
baptisent Clark. Son enfance, marquée par la mort de Jonathan, se déroule à peu
près normalement. Au terme de ses études, il part vivre à New York pour
travailler au Daily Planet. Alors que
le terrible Lex Luthor menace la ville, il décide d’utiliser ses pouvoirs et
ses forces supérieures pour protéger les habitants et faire régner la justice…
Qu’on
se le dise d’entrée, ce film a tout du navet. Surproduction hollywoodienne au
pire des sens du terme, il met en scène un héros fade, par le biais d’un
scénario mille fois revu. Les acteurs sont mauvais (même les bons), pas même beaux, et il dure
bien trop longtemps (2h30).
Et
puis, Superman a toujours été le super-héros le moins passionnant…
Peut-être
parce que quand Spiderman tombe un peu trop dans le bizu éxagéré et Batman dans
le milliardaire gentleman qui a la classe, Superman n’arrive pas à se décider
entre son attitude de premier de la classe et son physique de quarterback
vedette du lycée. Peut-être parce que, vu qu’il vient d’une autre planète,
c’est un super-héros auquel il est bien plus difficile de s’identifier.
Toujours est-il que, au cinéma, son côté fait sur-mesure et naturellement supérieur aux
hommes, a toujours créé une certaine distance, et dégagé une niaiserie de bonté telle que l'on se lasse bien vite de ses petites aventures.
Néanmoins, si l'on parvient à faire abstraction ou à adopter ces aspects-là, le film est assez plaisant à regarder. Le côté grosse potiche de
Christopher Reeve lui donne un capital sympathie énorme et s’accorde
harmonieusement avec le côté grosse potiche de Lois. La coupe de cheveux de
Marlon Brando étonne, surprend et amuse, bien avant de discréditer Jor-El. Et
Gene Hackman en Lex Luthor, pas aidé non plus par le texte qui le fait répéter
qu’il est « le plus grand esprit criminel du siècle » une dizaine de
fois, nous est là aussi bien plus sympathique qu’antipathique. On est presque
étonné qu’il y ait des morts dans ce film, qui semble être une bonne comédie à
base de pouvoirs magiques.
Si
l’on regarde ce qu’il y a derrière le film, dans les studios, on est en
revanche bien loin de la rigolade.
Avec un budget de 55 000 000 de dollars (dont 4 pour Marlon Brando et ses 10 minutes de prestation…), le tournage ne dura pas loin de deux ans (19 mois). C’est John Williams, qui s’était démarqué deux ans plus tôt avec la composition des thèmes magistraux et intemporels de La Guerre des étoiles, qui signe la musique (là aussi, bien fade et déjà entendue mille fois).
Avec un budget de 55 000 000 de dollars (dont 4 pour Marlon Brando et ses 10 minutes de prestation…), le tournage ne dura pas loin de deux ans (19 mois). C’est John Williams, qui s’était démarqué deux ans plus tôt avec la composition des thèmes magistraux et intemporels de La Guerre des étoiles, qui signe la musique (là aussi, bien fade et déjà entendue mille fois).
Du
côté des effets spéciaux, un fois encore, le ridicule amuse, avant de discréditer. Quand on pense
que Star Wars est sorti deux ans plus
tôt, avec un budget bien plus réduit, on se demande un peu ce qu’il s’est passé. Certains sont
réussis, aucun n’est véritablement crédible, mais la plupart sont amusants.
Globalement,
on regrettera que le film soit aussi long (notamment le générique
d’introduction et, de manière plus générale toute la première partie sur Krypton). Pour le
reste, tout dépendra de la patience et de l'humour de chacun.






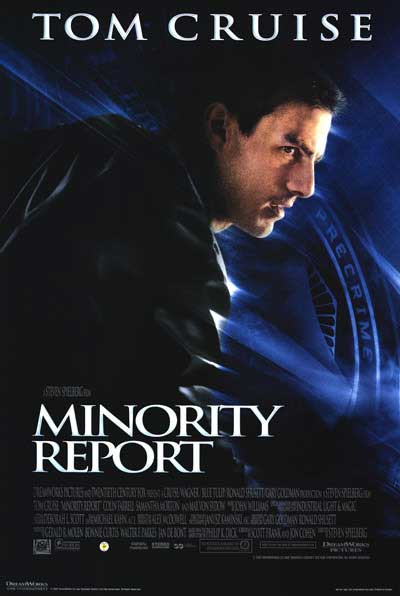









.jpg)